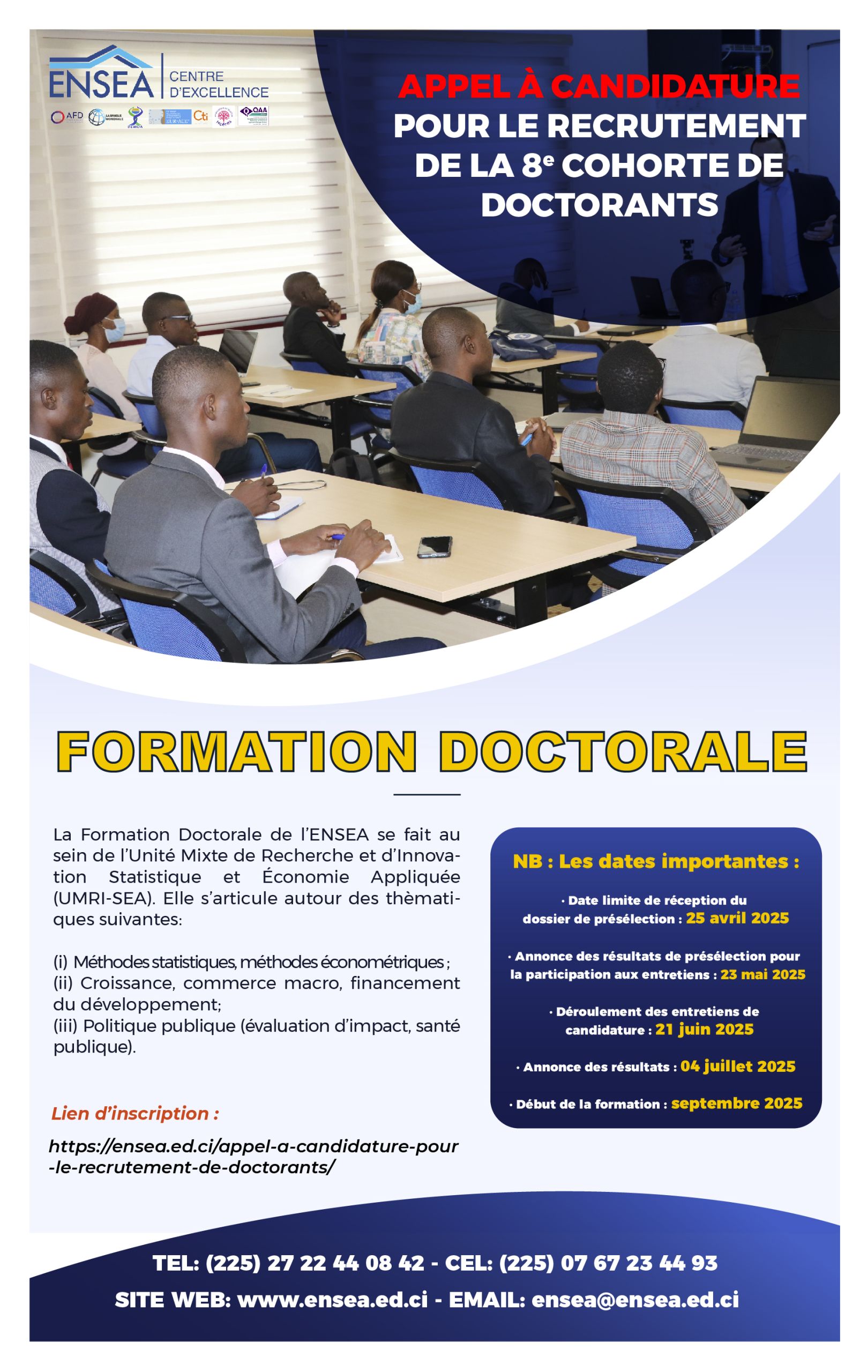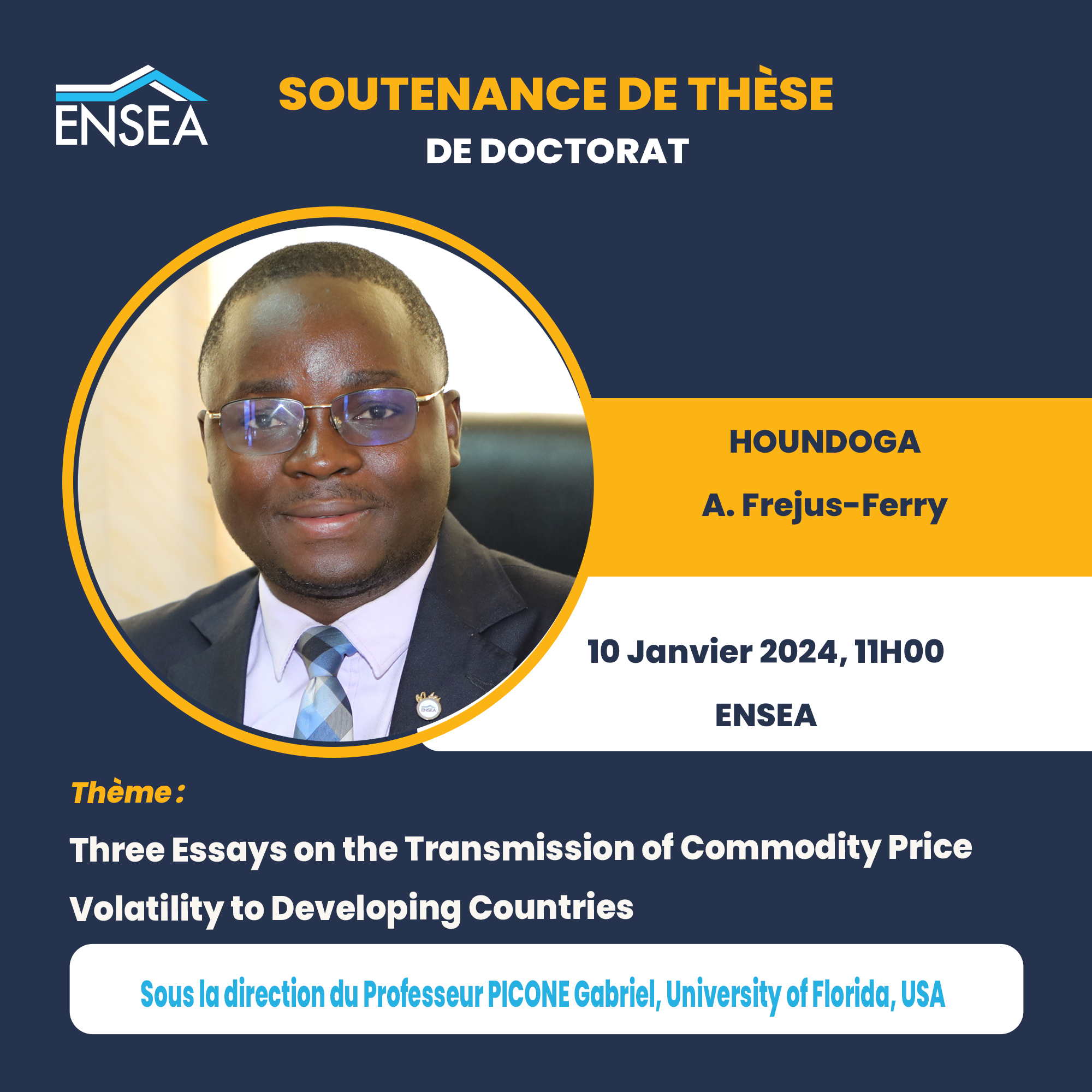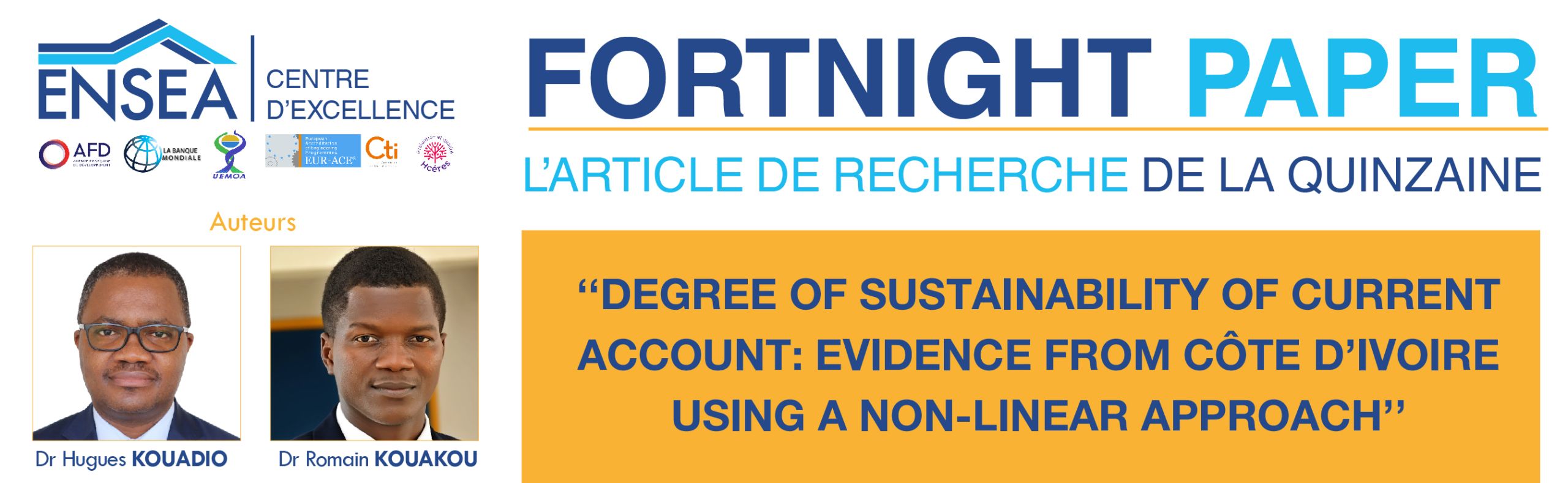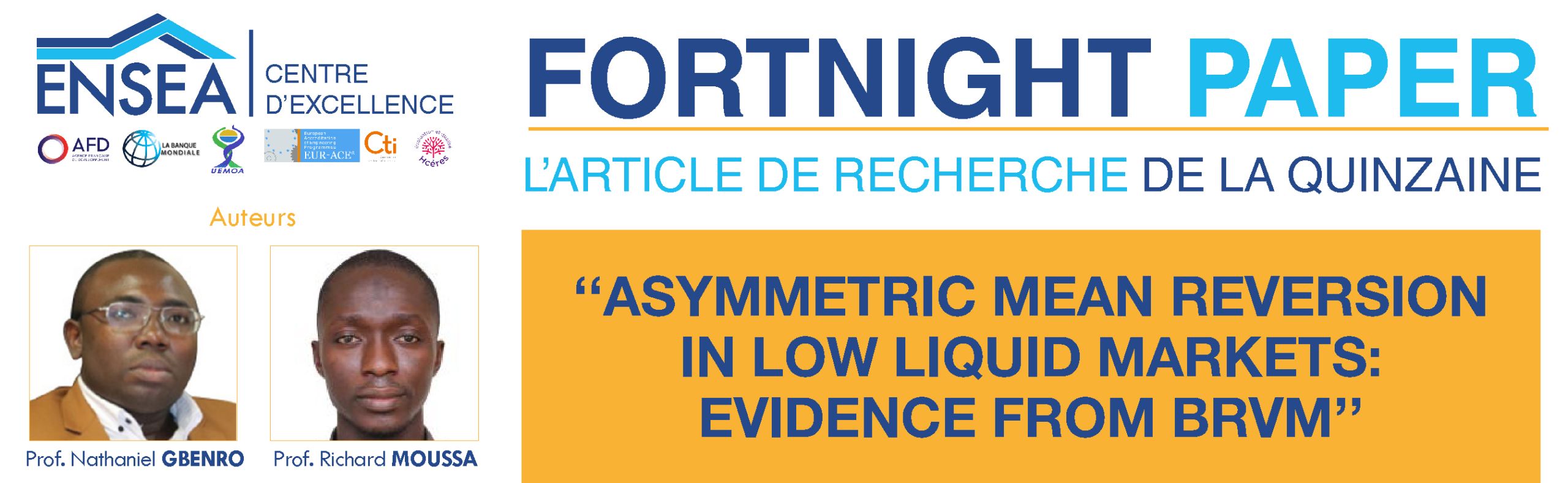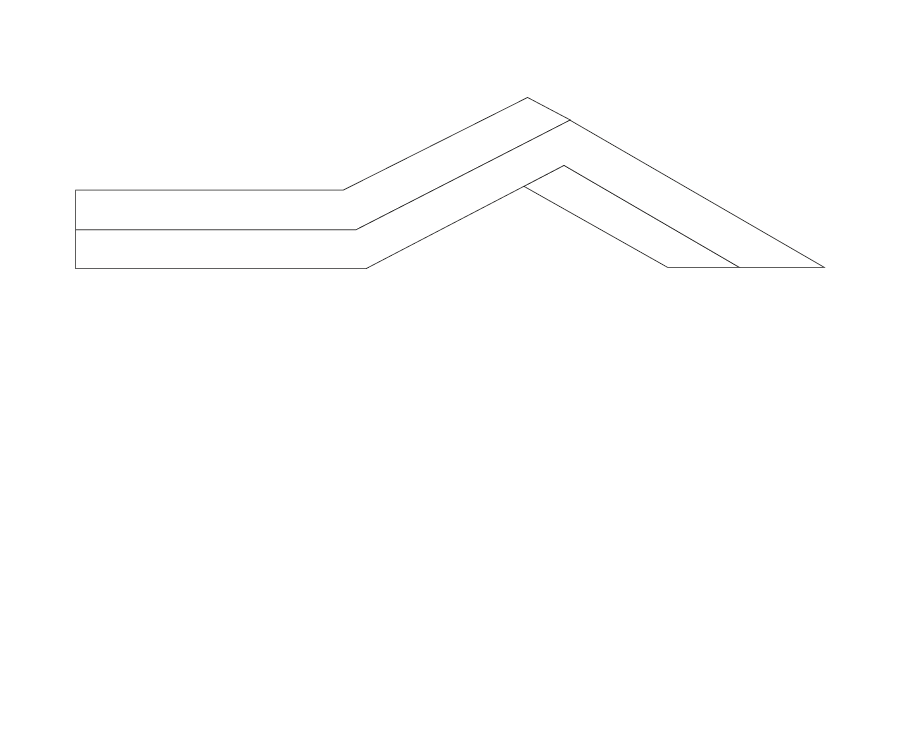Chocs exogènes et stratégies de résiliences des économies en développement
L’histoire de l’économie mondiale a été marquée par de nombreux chocs, comme en témoigne la crise financière de 1929 qui partie de Wall Street s’est rapidement étendu à l’ensemble de l’économie américaine, puis à l’économie mondiale. En effet, depuis 1929 jusqu’à nos jours, force est de constater que l’économie mondiale a dû faire face à de multiples chocs à intervalles de temps irréguliers et de magnitude variable.
Un choc exogène peut être défini comme un événement d’origine extérieur qui a des effets négatifs sensibles sur l’économie mais qui échappe au contrôle du gouvernement. Il peut s’agir d’une évolution défavorable des prix des produits de base, y compris le pétrole, ou d’une catastrophe naturelle, ou d’une crise sanitaire, ou encore d’une perturbation des échanges commerciaux consécutives à un conflit ou à une crise dans un ou des pays voisins.
Les chocs exogènes sont dans une large mesure inattendus et l’impact généré échappe généralement aux anticipations des marchés. Il existe plusieurs types de chocs, certains affectant la demande, d’autres l’offre, d’autres encore ont une incidence à la fois sur la demande et sur l’offre. Ils sont en outre susceptibles d’exercer des effets temporaires ou plus durables sur l’activité économique compte tenu de la vulnérabilité des pays. Quant à leur diffusion, ces derniers sont susceptibles de se répercuter largement sur la plupart des branches économiques.
Selon les analyses économétriques, il se dégage une forte corrélation entre les chocs exogènes et les variables macroéconomiques. En effet, outre la destruction du capital et les pertes de revenus, les chocs exogènes peuvent avoir des répercussions indirectes sur une économie : baisse de la production et de l’investissement, déséquilibres macroéconomiques, détérioration des indicateurs de la dette publique.
Les effets des chocs exogènes n’épargnent aucun pays, et encore moins les pays en développement qui en réalité sont plus vulnérables en raison de leur incapacité à se protéger en constituant des réserves de fonds ou en consolidant leurs recettes publiques. Récemment, la crise du COVID19 et la crise ukrainienne ont mis à nu cette vulnérabilité des pays en développement face aux chocs exogènes. En effet, selon la banque mondiale, les mesures de relance budgétaire prises par les gouvernements à travers le monde pour faire face aux effets du COVID19 se sont traduites en 2020 par une hausse de 12% du poids de la dette des pays à faible revenu. Tandis que le volume de la dette extérieure des pays à revenu faible et intermédiaire a globalement augmenté de 5,3% en 2020 pour atteindre le niveau record de 8700 milliards de dollars (Banque mondiale ,2022). La Banque Africaine de Développement (BAD) a estimé que les pays africains ont besoin de 432 milliards de dollars US pour faire face aux impacts socioéconomiques de la COVID19 (BAD, 2022).Concernant la crise ukrainienne, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne sont particulièrement vulnérables aux retombées de cette dernière selon le FMI, notamment en raison de la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, de la réduction du tourisme et des difficultés potentielles d’accès aux marchés de capitaux internationaux. Les prix record du blé sont particulièrement préoccupants pour cette région dont les importations représentent environ 85 % de l’approvisionnement, dont un tiers provient de Russie ou d’Ukraine.
En outre, selon la BAD, l’adaptation au changement climatique pourrait couter au continent africain au moins 50 milliards de dollars US par an d’ici 2050.Pourtant, l’Afrique affiche les flux de financement climatique par habitant les plus faibles au monde, un constat en contradiction avec les principes d’une véritable justice climatique (BAD,2022).
La vulnérabilité économique des pays africains et en général des pays en développement n’est pas une question nouvelle. Dans de nombreux travaux économiques, le problème de l’instabilité, spécialement celle des exportations des produits de base et des prix internationaux, la non-diversification de la production sont les principaux canaux de transmission des effets des chocs exogènes aux économies en développement.
Dans ce contexte, afin de contrer les effets pervers des chocs exogènes dans les pays en développement, des stratégies de résiliences sont développées. A ce titre, on peut citer la facilité de protection contre les chocs exogènes du FMI qui fournit un soutien à la politique économique et une aide financière aux pays à faible revenu qui subissent les effets de perturbation externes. Sur le plan africain, on peut citer quelques mécanismes, notamment, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et de la CEDEAO qui contribuent à la prévention et au règlement des conflits en Afrique. Nous pouvons également mentionner la Stratégie Régionale Africaine pour la Réduction des Risques des Catastrophes. Le but de cette stratégie est de contribuer à l’avènement d’un développement durable et à l’éradication de la pauvreté en intégrant la réduction des risques de catastrophes au développement. La Banque Africaine de Développement s’investit également de plus en plus dans le domaine de la réduction de la vulnérabilité. Nous constatons aussi que les Etats ne sont pas en marge de cette dynamique. En effet, à leur niveau, ils développent également des stratégies de résilience en reformant leur politique économique, en adaptant leur politique budgétaire et monétaire, et en établissant des mesures permettant d’atténuer l’effet des chocs quand ils se produisent.
Cependant, en dépit de ces initiatives, force est de constater que les pays en développement ne sont toujours pas à l’abris des affres des chocs exogènes comme le témoigne les effets de la dernière crise sanitaire et ceux de la crise ukrainienne. La question des chocs exogènes et des stratégies de résiliences adaptées est donc plus que jamais d’actualité. Il est essentiel pour le bien-être économique, social et matériel des pays en développement de développer des stratégies d’adaptation, d’atténuation et de résilience plus efficaces face aux effets des chocs exogènes. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette édition du CISEA 2023.
APPEL À COMMUNICATIONS
Dans le cadre de la troisième édition de la Conférence Internationale de Statistique et d’Economie Appliquée (CISEA-2023) qui aura lieu du 20 au 21 Juin 2023 à l’ENSEA d’Abidjan, Côte d’Ivoire, l’ENSEA lance un appel à communications aux chercheurs, doctorants et praticiens. Le thème général de cette année qui est « Chocs exogènes et stratégies de résiliences des économies en développement » met en avant les stratégies de résilience des économies en développement face aux multiples chocs exogènes (COVID-19, crise Russo-Ukrainienne etc.). La conférence réunira des académiciens de renom, des chercheurs, des professionnels, des praticiens et des experts.
APPEL À SESSIONS
La conférence sollicite des propositions pour les sessions. Tout chercheur participant à la conférence peut proposer d’organiser une session. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la conférence.
NB: L’ensemble des articles acceptés par le comité de sélection seront publiés dans les actes du colloque.
Les propositions sont à envoyer à: cisea@ensea.ed.ci

Comment s’y rendre?
La Conférence se déroulera durant les deux jours à l’ENSEA d’Abidjan.
L’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) est située dans la Commune de Cocody sur le boulevard Mitterrand, à l’avenue des grandes écoles.
Localisation: https://goo.gl/maps/Lo5qoWvdYnA9Y9tu6
Les moyens de locomotions pour s’y rendre sont:
- les taxis communaux
- les structures privées de location de véhicules
Pour toutes informations, merci d’envoyer un email à l’adresse suivante: cisea@ensea.ed.ci
Frais de participation
L’inscription à cette édition 2023 du CISEA est gratuite pour toutes les personnes dont les papiers seront acceptés. L’inscription comprend:
- La participation aux activités scientifiques
- Les déjeuners
- Les pauses café
- Le diner de gala
L’inscription n’inclut ni l’hébergement ni les frais de transport.
Visa
Il est de la responsabilité du participant d’examiner le statut de son visa et de déterminer s’il en a besoin ou s’il lui faut un renouvellement de visa pour se rendre en Côte d’Ivoire où la conférence aura lieu. De plus, c’est au participant de payer les frais afférents et de s’enquérir des instructions quant au processus de demande de visa. Il est aussi possible de faire une demande visa en ligne.
N’hésitez surtout pas à contacter le Comité d’organisation pour toute question concernant les visas.
Veuillez noter que les lettres de visa ne seront délivrées que sur demande du Comité d’organisation.
Pour les détails qui s’appliquent spécifiquement à votre pays, veuillez consulter le site Web du consulat ou de l’ambassade de Côte d’Ivoire le plus proche.
Toutes les demandes de lettres de visa doivent être adressées au Comité d’organisation.
Information pour le voyage
Aéroport de destination de la conférence: Aéroport International Felix Houphouët Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire).
Les compagnies aériennes internationales qui se rendent à Abidjan sont: Ethiopian Airlines, Kenya Airways, South African Airlines, Emirates, Turkish Airlines, Air France, Brussels Airlines, Air Côte d’Ivoire, Air Burkina, etc.
Tarifs d’hôtel: Les tarifs d’hôtel décents varient entre 50 $ et 100 $ par nuit. Quelques hôtels luxueux pourraient aller jusqu’ à 500 $.
Climat: En juin, le temps est assez chaud.
Tourisme: La Côte d’Ivoire a de belles plages (Bassam, Assinie, Jacquesville, etc…). Veuillez consulter le site du Ministère du Tourisme. (http://www.tourisme.gouv.ci). Pour de plus amples renseignements sur la conférence, veuillez contacter le Comité d’organisation.
Comité d’Organisation
Auteurs et Titres des Articles à présenter
Estimation and asymptotic properties of a stationary univariate GARCH (p, q) process
Résumé: Dans ce papier, nous déterminons l’Estimateur du Minimum de Distance de Hellinger d’un processus GARCH univarié stationnaire. Nous construisons un estimateur basé sur la méthode du Minimum de Distance de Hellinger. Sous les conditions de φ-mélange du processus GARCH, nous établissons les propriétés asymptotiques de cet estimateur.
Impact de la crise Russo-ukrainienne sur le commerce extérieur et la pauvreté en Côte d’Ivoire
Résumé: Cette étude évalue l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur le commerce extérieur et la pauvreté en Côte d’Ivoire. Elle entend apporter un éclairage pour la prise décision des pouvoirs publics au sujet des mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de ce conflit après une évaluation quantitative de ses impacts sur des variables clés de l’économie. Un modèle d’équilibre général calculable dynamique a été construit à cet effet sur la période 2021 à 2025 avec comme année de base 2015. Les canaux de transmission de la crise choisis sont la hausse des prix internationaux des matières premières, des hydrocarbures, des denrées alimentaires et la baisse des investissements directs étrangers entrant. Les résultats montrent que les exportations et les importations vont baisser et le taux de pauvreté va augmenter. Ces résultats suggèrent la nécessité de la diversification de l’économie et de la promotion de la transformation structurelle. En outre, des mesures doivent être prises pour contrer la baisse du pouvoir d’achat des ménages.
Résilience de la croissance économique en contexte pandémique : Une explication par les mesures de lutte contre la Covid-19
Résumé: L’objectif de cette étude est d’évaluer les effets des mesures de lutte contre la COVID-19 sur la résilience de la croissance économique en Afrique subsaharienne. Ainsi, les données d’Oxford sur les mesures de la COVID-19 ainsi que les données du Fond Monétaire International sur la croissance économique sont exploitées pour les tests d’hypothèses sur une période journalière sur un échantillon de 46 pays d’Afrique subsaharienne. Se basant sur les données sur le taux de croissance du produit intérieur brut, l’indice de résistance (sensibilité) est modélisé pour la période 2020 et l’indice de récupération quant à lui, modélisé pour l’année 2021. Ces indicateurs sont rendus journaliers pour des estimations économétriques. Pour la modélisation économétrique, conformément à la littérature empirique, nous nous inspirons du modèle mathématique N-SIRD, transformé en équations linéaires estimables par les moindres carrés ordinaires. Les résultats montrent que, l’indice de rigueur, la restriction au rassemblement des personnes, le respect du transport en commun, la quarantaine, le contrôle des voyages internationaux, les réponses gouvernementales et l’allègement de la dette favorisent la résistance et la récupération de la croissance économique. Par contre, le confinement, la fermeture des écoles, la fermeture des lieux de travail, l’annulation des événements publics et l’indice des supports économiques ou l’indice économique réduisent la résistance et la récupération de la croissance économique. L’étude suggère aux gouvernements des pays d’Afrique subsaharienne une échelle de résistance de la croissance économique.
.
Electricity consumption pattern for new subscribers: how does electricity consumption habits form ?
Résumé: We investigate electricity consumption habits formation in Cote d’Ivoire, with a focus on new subscribers. Electricity consumption habits are one of the factors behind the rapid growth of residential electricity consumption worldwide and may result in inertia and inefficient electricity consumption. Using the National Electricity Company unique database, we find highly persistent habits in electricity consumption, with persistence growing over time. These results call for designing policy for promoting electricity efficiency among new subscribers to help combating energy inefficiency by enhancing good electricity consumption habits at household level.
.
.
Stratégies de Résiliences aux Chocs Agricoles et leurs effets sur les Exploitations agricoles familiales en Milieu Rural au Sénégal
Résumé: L’agriculture familiale est une source importante de revenu pour les populations rurales au Sénégal. Mais, à cause des effets des chocs agricoles couplés aux aléas du changement climatique, les exploitants agricoles ne parviennent pas à accroitre leur production, encore moins leur revenu. Face à ces chocs et aléas, les exploitants agricoles se sentent obligés d’adopter les stratégies d’adaptation, de résistance et prévention pour les potentiels chocs futurs. L’objectif de cette proposition de recherche est d’analyser les stratégies de résilience des exploitations agricoles familiales en milieu rural et d’évaluer l’effet de ces stratégies de résilience sur la productivité des exploitations. Pour ce faire, nous mettons l’accent sur trois objectifs spécifiques. Tout d’abord, nous identifions les stratégies de résilience les plus pertinentes utilisées par les exploitations agricoles familiales en milieu rural à partir d’une analyse de type descriptif. Ensuite, nous identifions les principaux facteurs qui limitent ou favorisent l’adoption de ces différentes stratégies de résilience en utilisant un modèle Probit multivarié. Et enfin, nous évaluons l’impact des stratégies de résilience sur la productivité des exploitations agricoles familiales. Les résultats montrent que la constructions des digues, la rotation des cultures et l’utilisation des semences certifiées sont les stratégies de résilience des exploitations agricoles en milieu rural les plus pertinent face aux chocs agricoles et climatiques. L’analyse multivarié montre que l’adoption des stratégies de résilience des exploitations familiales est fortement liées aux variables climatiques, au niveau d’instruction du propriétaire de l’exploitation, de la taille du ménage agricole et au zone agroécologiques. L’évaluation d’impact montre que ces stratégies de résilience allogènes ont un impact significativement positif sur la productivité des exploitations agricoles familiales en milieu rural.
On change point detection in regression function using nonparametric autoregressive processes
Résumé: We propose a new test to detect a change in the conditional mean of Nonparametric AutoRegressive processes. This test is based on the combining CUSUM and marked empirical processes. Our CUSUM test requires an estimator of the regression function to make it asymptotically distribution free under the no change null hypothesis. As a consequence, we obtain convergence of the developed test statistic. We show the asymptotic consistency of the test when the difference between the regression functions before and after the break is constant. We illustrate the applicability of our method by the means of Monte-Carlo simulation.
.
M-Estimate for the stationary hyperbolic GARCH models
Résumé: In this manuscrit,we propose two classes of M-estimates for the hyperbolic GARCH models. The first class called M-estimate is defined by minimizing of a convenient bounded loss function. These cond, called BM-estimate is a modified version of the first with a mechanism that limit st he propagation of the effect of outliers in the conditional variance.The asymptotic properties of these classes of M-estimates are established. According to the Monte Carlo study, we compare the performance of the M and BM-estimates with that of the quasi maximum likelihood (QML) estimate. We show that the proposed M and BM-estimates are less affected by outliers than the QML-estimate. Moreover, in the last part, an empirical example indicates that the studied M-estimate is the best for the out-of-sample forecasting.
.
Asymptotic properties of non-parametric quantile estimation with spatial dependency
Résumé: The purpose of this work is to nonparametrically estimate the conditional quantile for a locally stationary multivariate spatial process. The new kernel quantile estimate derived from the one of conditional distribution function (CDF). The originality in the paper is based on the ability to take into account some local spatial dependency in estimate CDF form. Consistency and asymptotic normality of the estimates are obtained under 𝛼-mixing condition. Numerical study and application to real data are given in order to illustrate the performance of our methodology.
Le lien entre la durée des mandats du régime démocratique et la formalisation du secteur informel : Preuve théorique du cas de la Côte d’Ivoire
Résumé: L’objectif principal de cet article est d’analyser l’effet de la durée des mandats du régime démocratique sur la formalisation du secteur informel en Côte d’Ivoire. Pour mener à bien cette recherche, nous avons développé un modèle théorique en modélisant dans un premier temps une fonction de durabilité au pouvoir du principal. L’objectif était d’analyser comment se comporte la fonction de durabilité au pouvoir de l’autorité centrale en fonction du choix de la politique menée dans un environnement politiquement concurrentiel dans un premier temps. Dans un second temps, nous avons modélisé une fonction de recette nette future du principal qu’il maximise sous la contrainte de sa durabilité au pouvoir. Comme résultat, cette recherche a démontré que compte tenu de la concurrence politique et de la durée des mandats qui relativement courte dans le régime démocratique, lorsque le degré d’engagement de l’autorité centrale est élevé dans la formalisation du secteur informel qui s’inscrit dans le cadre des politiques structurelles et dont les effets sont perçus sur le long terme, cela agit négativement sur la durabilité de son pouvoir. Ainsi, nous trouvons que la concurrence politique limite l’autorité centrale à s’engager plus dans la formalisation du secteur informel qui désigne en réalité une action du long terme dans la mesure où la durabilité de son pouvoir décroît lorsqu’il choisit de sacrifier ses ressources disponibles pour inciter les acteurs de l’informel à passer au formel. Par ailleurs, nos résultats montrent encore que dans le régime démocratique, le degré d’engagement du principal en termes d’incitation fiscale pour la formalisation est réduit par son autonomie politique de courte durée.
Climate Change and Farm Household Income in Northern Cameroon: A Ricardian Analysis
Résumé: Using a Ricardian model, this study aims at assessing the impact of climate change on agricultural incomes in the periphery of the Bouba Ndjida National Park in northern Cameroon. The data used come from a survey of 450 farming households in 23 villages around the park. Since using cross-sectional data very often encounters problems of heteroscedasticity, multicollinearity and outliers in the estimates, quantile regression has been applied in this study. The results show that a 1mm increase in rainfall leads to an increase of 12.68 USD in farm income per hectare in summer, 0.92 USD in winter, 9.59 USD in spring and 13.30 USD in autumn. While a 1°C increase in temperature leads to a decrease in net farm income per hectare of 3.54 USD in summer, 1.26 USD in winter, 3.40 USD in spring and 6.11 USD. Furthermore, the results indicate that farm income is more sensitive to precipitation than to temperature. We also found that a temperature increase of 1.2°C coupled with an 8% decrease in precipitation will lead to a 31.13% loss in income. This loss represents more than 72% of net farm income if precipitation decreases by 16%. While an increase in temperature of 4.8°C combined with a decrease in precipitation of 8% will result in a loss of 42.8%, which can reach 78.6% if precipitation decreases by 16%. Thus, climate change, by imposing a new environment on households, concomitantly implies new economic policy orientations in the fight against food insecurity and poverty in the North Cameroon region. Measuring and analyzing the impact of climate change on agriculture is a necessary condition for making informed and anticipatory decisions that integrate both the risks and opportunities induced by climate change.
Estimation in the zero-inflated bivariate Poisson model with an application to health-care utilization data
Résumé: Data on the demand for medical care is usually measured by a number of different counts. These count data are most often correlated and subject to high proportions of zeros. However, excess zeros and the dependence between these data can jointly affect several utilization measures. In this paper, the zero-inflated bivariate Poisson regression model (ZIBP) was used to analyze health-care utilization data. First, the asymptotic properties of the maximum likelihood estimator (MLE) of this model were investigated theoretically. Then, asimulation study is conducted to evaluate the behaviour of the estimator in finite samples. Finally, an application of the ZIBP model to health care demand data is provided as an illustration.
Analyse des déterminants de la violence domestique en période de crise sanitaire : cas de la côte d’ivoire
Résumé: En utilisant les données de l’enquête quantitative menée par la cellule d’analyse de politiques économiques du CIRES auprès des ménages vulnérables de la zone du grand Abidjan du 01 Octobre 2021 au 02 Novembre 2021 nous analysons les déterminants de la violence domestique en période de covid 19, nous utilisons les vignettes pour extraire deux indices respectivement de la perception de la violence physique et de la perception de violence verbale et par la méthode des variables instrumentales nous trouvons que pendant les périodes de fortes restriction liées à la covid 19, (i) Lorsque nous passons du milieu rural au milieu urbain, nous avons une baisse des croyances ou des perceptions vis-à-vis de la violence physique et (ii) Lorsque nous avons un pouvoir de décision dans le ménage, notre approbation de la violence verbale diminue.
L’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les marchés financiers africains
Résumé: Dans les principaux marchés financiers africains, représentant près de 87% de la capitalisation boursière du continent, nous examinons les effets de la crise sanitaire Covid-19 sur le capital-risque marché. L’approche méthodologique retenue consiste à utiliser en premier lieu un modèle avancé de type ARMA-GjrGARCH-TVE, qui combine à la fois les modèles ARMA-GjrGARCH et la théorie des valeurs extrêmes (TVE), afin de déterminer la distribution marginale des rendements actions. En second lieu, nous recourons à la théorie des copules et la simulation stochastique pour appréhender respectivement la distribution multivariée des résidus standardisés, ainsi que les distributions conditionnelles des rendements. Enfin, nous évaluons le capital-risque des marchés actions à partir de la valeur à risque (VaR) et la valeur à risque conditionnelle (CVaR), tout en effectuant au préalable le backtesting des rendements simulés. Cette étude révèle que la crise Covid-19 constitue un facteur de risque important pour les marchés financiers africains, ce qui se traduit par une augmentation du capital-risque (VaR et CVaR) de l’ordre de 0,13% à 13,6%, en référence à la distribution normale. Dans ce contexte, cette étude plaide pour la promotion de la culture financière, la diversification des produits financiers et instruments de couverture, l’évolution de la réglementation des marchés financiers africains, ainsi que le renforcement de la base des investisseurs locaux afin de lutter contre la fuite des capitaux observée durant la crise sanitaire Covid-19.
The 1992-93 EMS Crisis and the South : Lessons from the Franc Zone System and the 1994 CFA Franc Devaluation
Résumé: The CFA franc devaluation on 11 January 1994 is the one major reform within the Franc Zone system since former African French colonies political independences in 1960, but subject to a profound taboo. So far, the economic literature made no connection between this major event in African macroeconomic history and its historical context : the 1992-3 European Monetary System (EMS) crisis. Using the narrative approach combined with a quantitative analysis (DCC-MGARH-X and SVARs), powered by an unprecedented set of archives data from the Banque de France, the Banque of England, and the Bundesbank, we document a brand-new route of understanding a certain integrated African-European common history, where evidence unveils the CFA devaluation as a fundamental role player in backing French franc market credibility amidst the 1992-3 EMS crisis. A new ‘Franc Zone’s Transition Committee’ at the Banque France, appears as a key feature for the future of the zone’s management.
.
Déterminants de la participation des femmes au marché du travail dans la CEDEAO
Résumé: En dépit de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en matière de santé et d’éducation, les disparités en matière de participation au marché du travail persistent en Afrique. Les femmes qui représentent au moins la moitié de la population représentent toutefois, moins de la moitié de la population active sur le marché du travail formel de la CEDEAO (Mbaye et Gueye, 2018). Ce document vise à identifier les déterminants de la participation des femmes au marché du travail, et partant les facteurs expliquant la prépondérance des femmes en emploi vulnérable dans la CEDEAO sur la période 1990 à 2018. L’utilisation de la méthode de pool mean group (PMG) a permis d’examiner la relation entre les variables. Les résultats montrent qu’à court terme, le taux de chômage des hommes, et à long terme, l’éducation, le produit intérieur brut par habitant, la fécondité sont les déterminants de la participation des femmes au marché du travail. Ainsi, le taux d’achèvement de l’éducation secondaire, le PIB per capita influencent positivement la participation féminine au marché du travail. Mais, la fécondité, le chômage des hommes et l’urbanisation découragent l’offre de travail féminine. A contrario, la fécondité et l’urbanisation influence positivement l’emploi vulnérable des femmes tandis que l’éducation réduit la présence des femmes dans l’emploi vulnérable. Sur la base de ces résultats, l’étude suggère d’encourager l’éducation des filles et des femmes afin de réduire la prépondérance des femmes en emploi vulnérable. Il faut également mettre en œuvre des politiques de planning familial afin de contrôler la fécondité des femmes dans la zone CEDEAO.
.
Dette publique extérieure et croissance économique dans la CEDEAO : rôle de la gouvernance
Résumé: L’objectif principal de cette étude est d’analyser le rôle de la CEDEAO dans la relation dette publique extérieure – croissance économique dans la CEDEAO avec ou sans le Nigéria. Pour ce faire, l’analyse économétrique a été réalisée à l’aide d’un modèle de régression à seuil en panel (PTR) introduit par Hansen (1999) et développé par Wang (2015). Notre étude s’applique à un panel équilibré constitué de douze pays de la CEDEAO sur la période 2004-2018. Il ressort de notre étude que lorsqu’on prend la dette publique extérieure comme variable de transition le seuil de la dette dans la CEDEAO avec le Nigéria qui est déterminé est de 57,36% du PIB, tandis que celui de la CEDEAO sans le Nigéria qui est déterminé est de 25,63% du PIB. Cependant, lorsque nous considérons les variables institutionnelles comme variables de transition, toutes les variables de gouvernance diminuent le seuil de la dette publique extérieure dans la CEDEAO avec le Nigéria, alors qu’on constate le contraire dans la CEDEAO sans le Nigéria. Toutefois, nos résultats impliquent économiquement que la qualité de la gouvernance peut affecter positivement et significativement (la corruption, l’efficacité du gouvernement, la qualité de la réglementation et l’Etat de droit) comme négativement et significativement (la stabilité politique et la voix citoyenne) le seuil de la dette publique extérieure de la CEDEAO.
Investissements Directs Etrangers Chinois et production manufacturière a haute intensité capitalistique en Afrique subsaharienne
Résumé: L’objectif principal de la présente étude est d’examiner la relation entre les Investissements Directs Etrangers (IDE) Chinois et l’intensité capitalistique de la production manufacturière en Afrique Subsaharienne (ASS). Il est pertinent de se pencher sur cette relation, car sa non prise en compte pourrait fragiliser la stratégie de résiliences des économies d’Afrique Subsaharienne aux chocs exogènes. A cet égard, la méthode GMM système en 02 étapes a été utilisée, sur des données issues de WDI (2020) et ONUDI (2022). Elles couvrent la période 2009-2018 pour 23 pays d’Afrique Subsaharienne. Les résultats indiquent que les IDE Chinois ont un effet positif, non significatif sur l’industrie manufacturière à haute intensité capitalistique. Contrairement aux IDE d’autres origines qui ont un effet positif et significatif sur celle-ci. En tenant compte du rôle du nombre d’employés chinois en ASS, il ressort que les IDE Chinois ont un effet négatif sur ce type d’industrie jusqu’à un nombre d’employés seuil, à partir duquel cet effet devient positif. Ce seuil est de 4564 employés Chinois en ASS. Ainsi, nous recommandons aux autorités compétentes d’encourager les IDE Chinois dans le secteur manufacturier subsaharien. Surtout, de faciliter l’intégration des travailleurs Chinois, afin d’améliorer l’intensité capitalistique de la production manufacturière subsaharienne.
Impact de l’expansion des banques panafricaines sur le crédit à l’économie en Afrique de l’Ouest : Approche par la méthode des différences de différences
Résumé: Le secteur bancaire africain a changé au cours de ces deux dernières décennies. L’un des faits marquant ce changement est l’expansion des banques panafricaines par l’absorption de banques domestiques. Afin de savoir l’impact de l’expansion des banques panafricaines sur le financement des économies des États d’Afrique de l’Ouest, cet article se propose d’évaluer l’impact de l’expansion des banques panafricaines sur le crédit à l’économie des pays d’Afrique de l’Ouest. À cette fin, nous employons la méthode des différences de différences avec effet de traitement hétérogène afin de comparer le crédit bancaire alloué à l’économie par les banques panafricaines nouvellement acquises par le moyen d’absorption des banques domestiques et le crédit bancaire alloué à l’économie par les banques domestiques en place et non absorbées. Nous construisons pour cela une base de données collectées manuellement à partir des états financiers des banques et des rapports publiés par la Commission Bancaire de la Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sur la période 2007-2020. Nos résultats issus de nos méthodes économétriques indiquent que globalement, l’impact de l’expansion des banques panafricaines sur le crédit à l’économie est positif mais n’est pas significatif. Ceci veut dire que l’expansion des banques panafricaines n’augmente pas significativement l’accès au crédit bancaire. En revanche, du point de vue spécifique, l’expansion des banques panafricaines impacte positivement et significativement le crédit à court terme tandis qu’à long terme, l’impact est positif mais pas significatif.
TIC et inclusion financière en Zone UEMOA
Résumé: Cette étude a un double objectif, elle analyse l’effet de l’utilisation des TIC sur l’inclusion financière et détermine la nature de la relation entre les TIC et l’inclusion financière dans les pays de l’UEMOA. Les données mobilisées sont celles de la BCEAO et la Banque Mondiale sur la période 2008-2020. Pour atteindre l’objectif général, nous avons utilisé un modèle à correction d’erreurs (MCE) et une approche de causalité (Toda-Yamamoto). Il en ressort que l’utilisation des TIC a un effet significatif et positif sur l’inclusion financière à long terme en zone UEMOA et qu’il existe une relation de causalité bidirectionnelle entre les TIC et l’inclusion financière au sein de l’union.
Facteurs de résilience des entreprises informelles en période de choc : cas de la Covid-19 en Côte d’Ivoire
Résumé: Cette étude vise à analyser les facteurs de résilience des entreprises informelle en période de COVID 19. Elle porte sur un échantillon de 758 entreprises informelles enquêtées en 2022 dans le cadre du projet international de recherche dirigé par la CAPEC et financé par le CRDI. En se basant sur des analyses descriptives et économétriques, à l’aide d’un Probit binaire, l’étude parvient à démontrer que les femmes ont été moins résilientes que les hommes et l’âge de l’entreprise booste la résilience de celle-ci. Aussi, l’expérience du manager, la formalisation partielle et l’innovation sont déterminants dans l’explication de la résilience des entreprises informelles mesurée par le maintien de l’emploi. Par ailleurs, les managers de niveau d’étude supérieur et ceux ayant reçu des financements pour le paiement des salaires ont été plus résilients en maintenant leur activité. Par contre les entreprises ayant connu des interruptions de travail avant le COVID-19 ont été moins résilientes. De même, la faiblesse du capital constitue un frein à la résilience des entreprises informelles en termes de maintien de l’activité. Au regard de ces déterminants, les actions des pouvoirs publics doivent renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et des personnes de faible niveau d’instruction, accorder plus d’appuis aux jeunes entreprises et poursuivre les appuis financiers destinés à financer les salaires en période de crise.
Diversification, transformation structurelle et développement économique : cas des pays d’Afrique subsaharienne
Résumé: L’objectif de l’article est d’analyser l’effet du niveau de développement et de la transformation structurelle sur la diversification des exportations des pays subsahariens. Considérant différents indicateurs de diversification, nous combinons une approche non-paramétrique et une approche paramétrique sur un échantillon de 41 pays d’Afrique subsaharienne pour la période 1995-2018. Nous aboutissons au résultat selon lequel les économies les plus développées et les plus avancées dans le processus de transformation structurelle ont plus de chance d’expérimenter une plus grande diversification de leurs exportations comparativement aux pays les moins avancés. Les analyses statiques mises en œuvre ne semblent pas valider la thèse de Imbs et Wacziarg (2003). Toutefois, les résultats dynamiques montrent la présence d’effets asymétriques du niveau de développement sur la diversification et confirment cette thèse à long terme. Quant à la transformation structurelle, il ressort l’existence d’une relation en U-inversée avec la diversification avec la présence d’effets asymétriques à long terme.
Analyse des déterminants de la résilience alimentaire des ménages face à un choc sanitaire : Cas de la Covid-19 en Côte d’Ivoire
Résumé: Non-Disponible
Résilience et mémoire des cours boursiers en période de chocs exogènes : approche par le modèle FIGARCH
Résumé: La présente étude analyse la capacité de résilience de la bourse régionale des valeurs mobilières en présence de chocs exogènes. Nous utilisons des données journalières de l’indice BRVM Composite, couvrant la période du 04 mars 2014 au 29 mars 2023, collectées sur le site investing.com. La statistique descriptive des rendements issus de la transformation de l’indice composite par la méthode de Campbell, Lo et Mackinlay (1996), présente une série non linéaire, asymétrique et leptokurtique. Nous captons à l’aide des variables muettes les effets des chocs sur un processus AR(2). La présence d’hétéroscédasticité dans la dynamique des résidus entraine l’utilisation d’un modèle de type GARCH et la recherche d’une mémoire longue implique l’utilisation de sa forme extensive FIGARCH. Nos résultats indiquent la présence de mémoire longue dans la dynamique des cours boursiers de la BRVM. Ce qui implique que la faible capacité de résilience face aux chocs. De ce fait, tous les chocs négatifs qui touchent directement ou indirectement la BRVM devraient être par une mise en place d’un plan de soutien comme celui initié par le gouvernement quelques jours après l’apparition du cas de covid car le marché est incapable de s’autoréguler en présence de chocs exogènes.
An empirical analysis of the social contract in the MENA region and the role of digitalization in its transformation
Résumé: This paper presents an empirical analysis of the social contract in MENA countries based on the conceptual framework proposed by Loewe et al. (2021). We suggest a simple operational model synthesizing a social contract’s three main characteristics: Participation, Protection, and Provision, between a government and its citizens. This empirical “3-P” framework allows us to investigate the role that government provision and protection may have on citizen participation, which is particularly pertinent given the political and economic development of MENA countries. We compare our evaluation of the health of MENA countries’ social contract to that of OECD countries, and find robust empirical evidence that the social benefits provided to citizens through improved delivery of basic services have come at the cost of impaired political Participation. This feature of the social contract in MENA may be considered as one of the root causes of the social turmoil some countries have been struggling with in recent decades. Digital transformation is one potentially powerful channel through which the relationship between government and citizens can improve, and we find that it has a three-year lagged positive effect on the quality of the social contract in MENA and that this effect is inversely U-shaped. This suggests that structural and institutional improvements in MENA countries are called for before the quality of their social contract reaches levels comparable to those of OECD countries.
Résilience des finances publiques ivoiriennes aux chocs de prix des matières premières
Résumé: L’objectif de cet article est d’examiner la résilience des finances publiques ivoiriennes aux chocs de prix du cacao et du pétrole brut, qui sont des matières premières stratégiques pour le bon fonctionnement de l’économie ivoirienne. En utilisant, principalement les données de la comptabilité nationale et de l’environnement international dans le cadre du modèle macro-structurel de demande, développé par McIsaac et al. (2021), nous montrons que la mise en œuvre de politique budgétaire de rigueur favorise la résilience des finances publiques ivoiriennes aux chocs de prix de cacao et de pétrole brut. En effet, l’implémentation de politique d’austérité budgétaire permet non seulement d’atténuer les effets déprimants des chocs de prix du cacao et du pétrole sur le taux de pression fiscale, mais aussi de réaliser une optimisation des dépenses publiques importantes sources de déséquilibre macroéconomique.
.
Impact du processus de restructuration de la dette souveraine sur les investissements directs étrangers (ide)
Résumé: La restructuration de la dette souveraine a des coûts considérables qui peuvent affecter l’efficacité économique et le bien-être des populations sur une longue période d’où l’intérêt des gouvernements et des agents économiques d’avoir une idée de ses conséquences sur les Investissement Directs Etrangers (IDE) qui sont considérés comme une des composantes essentielles de la croissance économique. Nous utilisons un panel non cylindré de 72 pays sur la période de 1975-2020 à partir des données de restructuration avec les créditeurs privés et des données d’Investissement Direct Etranger (IDE). En effet plutôt que de montrer la baisse des Investissements Directs Etrangers dans le processus de restructuration, nous caractérisons la perte à gagner en estimant des Average Treatment Effects à partir d’un estimateur doublement robuste, le Augmented Inverse Propensity Weighted(AIPW). Cette méthode d’analyse d’impact nous permet de régler la question de l’endogénéité de la restructuration, de manque de donnée et de capter ainsi un impact causal. Nous utilisons une nouvelle méthode économétrique laquelle méthode combine la méthode d’analyse d’impact et la méthode de projection locale de Jordà (2005) afin de mettre en exergue la dynamique moyenne sur le court terme (5 ans) des flux nets d’entrée des Investissements Directs Etrangers. Nos résultats nous permettent de tirer l’attention des gouvernements des pays débiteurs que les restructurations de la dette souveraine ne sont pas une panacée certes elles leurs donnent une marge de Manœuvre mais elles réduisent le niveau potentiel des Investissements Directs Etrangers (IDE) qui devrait transiter au sein de ladite économie sur une certaine période afin de booster la croissance économique source de bien-être. Par ailleurs, on retient que les restructurations qui interviennent sans un défaut sont plus couteuses que les restructurations post-défaut. Les coûts des IDE sont plus élevés dans les périodes d’expansion économique que dans les périodes de récession tandis que les coûts des restructurations sont identiques quel que soit le mode et l’intensité (PPTE ou non PPTE, forte intensité ou faible intensité) mais le reflux des IDE est plus fort lorsque la restructuration est combinée à une crise bancaire.
.
Is information asymmetry an obstacle for agricultural credit supply? Evidence from Benin using instrument variable approach
Résumé: There is a significant gap between agricultural financing policies and agricultural sector transformation objectives in sub-Sahara Africa. This transformation requires significant financial capital, access to which is unfortunately limited by the information asymmetry. This latter is considered as one of the major barriers limiting credit supply, as reported in the economic literature. This paper analysed the effect of information asymmetry on agricultural credit supply in Benin using a sample of 574 famers. This evidence is tested as a hypothesis using data from the 2018/2019 Harmonized Household Living Conditions Survey (EHCVM). The results obtained using the instrumental variable regression method show that the presence of information asymmetry between financial intermediaries and farmers reduces agricultural credit supply in Benin. The findings call for agricultural development policies that aim to facilitate credit contracting between financial institutions and farmers through the implementation of an effective system for sharing information on farmers’ default risk.
Role of Governance in Debt and income Relationship: Evidence from dynamic panel threshold model for Sub-Saharan African countries
Résumé: This paper aims to explore the mediating role of governance in the relationship between per capita income and public debt in Sub-Saharan Africa. From a neoclassical production function and a dynamic panel threshold model, the paper estimates a model based on a sample of 39 countries in Sub-Saharan Africa over the period of 2002 to 2019. Our results indicate a non-linear relationship between per capita income and public debt, which is influenced by the quality of governance. In particular, the impact of public debt on per capita income depends on the level of governance quality. A governance threshold is identified, showing a minimum level of good quality of governance from which public debt has a positive effect on income. Moreover, the paper identified the most critical governance dimensions for optimizing the relationship between public debt and per capita income and provided policy suggestions.
Effect of Uncertainty on Income Inequality in Developing Countries: the Stabilizing Role of Fiscal Policy
Résumé: This paper analyses the effect of uncertainty on income inequality on a dataset of 66 developing countries over the period 2000-2020. The generalized method of moments is used to address the problems of simultaneity and endogeneity. The results show that uncertainty, approximated in the study by the World uncertainty index – a new innovative measure of uncertainty – increases income inequality. However, the effect is not robust and depends on the fiscal position of the country. Uncertainty increases income inequality during periods when countries present fiscal deficits. However, during periods of fiscal surplus, there is no effect. These results reveal the important socio-economic stabilizing role that fiscal policy management plays during periods of uncertainty.
.
Does Chinese aid promote manufacturing industry in Africa ?
Résumé: We examine the effects of Chinese aid on manufacturing industry in Africa, using methodology that enables to account for endogeneity and heterogeneity across the sample. We find a negative and immediate effects on the manufacturing industry in Africa. We provide evidence that it is a brake on development of manufacturing industry in Africa since it is linked to the consumption of raw materials from China such as steel, aluminum, cement, timber used in the implementation of major infrastructure projects in Africa. Our study brings two major contributions. The first one is the empirical implementation of the theoretical framework developed by McCormick (2008) which illustrates how manufacturing industry could be promoted by Chinese aid, especially targeted aid to productive infrastructure. Second one provides new evidence on how Chinese aid, which is tied, hinder manufacturing industry promotion in Africa. Therefore, policymakers should ensure that this aid is not linked to the purchase of raw materials from China needed to implement infrastructure projects when they are produced and available by local industries.